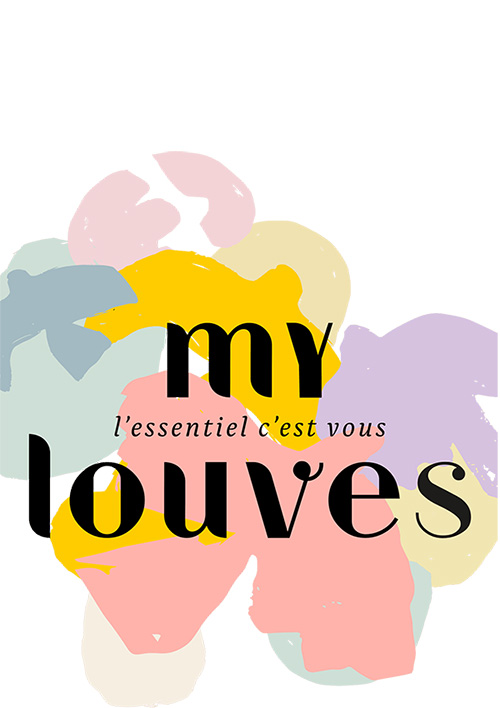Dys, TDAH, TSA… Ces sigles sont de plus en plus présents dans la vie des parents, tout comme les questions qu’ils soulèvent : comment comprendre les besoins de nos enfants neuroatypiques et les aider à grandir sereinement ? Au moment où les apprentissages se structurent, chaque difficulté peut sembler un obstacle de plus sur leur chemin. Comment les soutenir sans les enfermer dans un diagnostic, et préserver leur plaisir d’apprendre comme leur confiance en eux ? Orthophoniste et spécialiste des troubles de l’apprentissage, Laura Marie signe un guide clair et bienveillant pour aider les familles à accompagner leurs enfants au quotidien. Elle nous partage ses conseils.
Que signifie le terme neuroatypique ?
Le terme « neuroatypique » désigne une personne dont le fonctionnement cérébral diffère du développement dit « typique ». Cela inclut les enfants présentant des troubles « dys » (comme la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie), un TDAH, un TSA, mais aussi ceux qui présentent un bégaiement, un trouble développemental du langage ou des troubles moteurs comme le trouble développemental de la coordination (dyspraxie).
Dans ce livre tu œuvres pour chasser les préjugés comme celui-ci : les enfants neuroatypiques seraient par exemple moins intelligents. Comment réfuter cette idée ?
C’est un préjugé encore très répandu, et pourtant complètement faux.
Les enfants neuroatypiques ne sont pas moins intelligents, bien au contraire. D’ailleurs, pour poser un diagnostic de trouble « dys », de TDAH ou de TSA, on vérifie justement que l’efficience intellectuelle est dans la norme, voire supérieure. Ces troubles ne relèvent pas d’un déficit global, mais d’un fonctionnement cognitif différent, qui touche certaines fonctions plus que d’autres. Un enfant dyslexique, par exemple, peut avoir des difficultés à automatiser la lecture, mais posséder un excellent raisonnement mathématiquement.
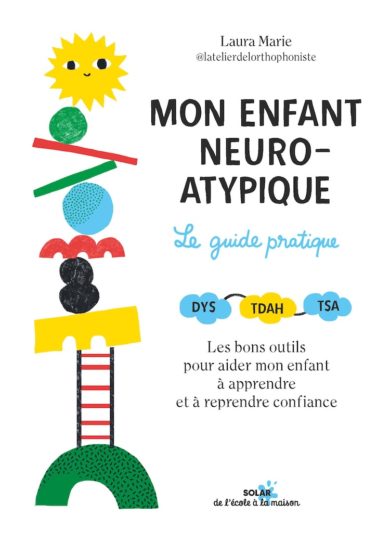
On connaît depuis longtemps les troubles « dys » (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie), sont-ils désormais mieux repérés, mieux pris en charge et surtout, sont-ils bien compris et tolérés par les enseignants ?
Oui, les choses évoluent dans le bon sens, même si tout n’est pas encore parfait. Les troubles « dys » sont aujourd’hui mieux identifiés qu’il y a dix ou quinze ans, et la sensibilisation du monde enseignant progresse. Beaucoup d’enseignants ont envie de bien faire, mais manquent encore parfois d’outils concrets pour adapter leurs méthodes au quotidien.
Dans ma pratique, je constate une vraie avancée : les parents consultent plus tôt, les écoles repèrent plus facilement une difficulté persistante, et le dialogue entre familles, enseignants et professionnels de santé est plus fluide.
Le défi, maintenant, c’est d’aller au-delà du repérage pour mieux comprendre le fonctionnement cognitif de ces enfants. Un élève « dys » ne manque pas d’effort ni de motivation : son cerveau apprend autrement.
Depuis quelques années on entend beaucoup parler des troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et des troubles du spectre autistique (TSA), comment les décrire et les identifier ?
Ces deux troubles font partie des troubles du neurodéveloppement, c’est-à-dire des particularités qui apparaissent dès l’enfance et traduisent une autre manière pour le cerveau de se développer et de fonctionner.
Le TDAH se caractérise par des difficultés à réguler l’attention, l’impulsivité et parfois l’activité motrice. L’enfant a du mal à rester concentré sur des tâches monotones, à filtrer les distractions, ou à différer ses réactions. Ce n’est pas un manque de volonté : son cerveau gère différemment la régulation de l’attention et des émotions.
Le TSA, lui, englobe un ensemble de manifestations liées à la communication et aux interactions sociales, associées à des comportements ou des intérêts restreints et répétitifs. Les enfants autistes ont une manière singulière de percevoir le monde, de comprendre les codes sociaux ou de gérer les stimulations sensorielles.
Il n’est pas rare du tout que ces deux troubles soient associés. Les études rapportent que près de 40 % des personnes autistes ont un également un TDAH associé. On ne connaît pas encore tout de ces troubles et de ce qui peut les rapprocher, mais on a enfin compris que l’un n’excluait pas l’autre, ce qui n’était pas le cas il y a encore quelques années.
Le TDAH en particulier semble concerner de plus en plus d’enfants. Pourquoi selon toi ?
D’abord, il y a une meilleure connaissance du trouble et un repérage plus fin. Pendant longtemps, ces enfants étaient simplement qualifiés de « rêveurs », « turbulents » ou « impatients », sans que l’on comprenne la nature du trouble. Aujourd’hui, la connaissance du TDAH a progressé, la parole s’est libérée, et les diagnostics sont posés plus tôt et plus précisément.
Ensuite, notre mode de vie actuel joue un rôle dans la visibilité du trouble. La multiplication des écrans, la surcharge de stimulations, la baisse du temps de mouvement ou d’attention partagée peuvent accentuer les difficultés d’autorégulation chez certains enfants. Le TDAH n’est pas causé par ces facteurs, mais le contexte moderne met davantage en évidence des fragilités qui passaient autrefois inaperçues.
Je pense qu’il faut aussi interroger notre regard sur la norme et sur ce qu’on considère comme un handicap. Autrefois, dans des sociétés plus rurales ou dans des métiers manuels, une forte activité motrice pouvait être valorisée. Un enfant ou un adulte très énergique, qui travaillait vite et beaucoup, n’était pas perçu comme « hyperactif » ou « intenable ».
Aujourd’hui, nos environnements exigent au contraire de rester assis, concentré, silencieux et disponible à la consigne pendant de longues périodes. Ce cadre accentue forcément la visibilité du TDAH, car il met ces enfants face à un modèle d’attention et de comportement qui ne correspond pas à leur fonctionnement.
Enfin, il est aussi possible que certains facteurs environnementaux jouent un rôle, comme l’exposition à des polluants ou certains aspects de l’alimentation. Ces pistes sont actuellement à l’étude, mais à ce jour, aucun lien de causalité n’a été démontré scientifiquement. On ne peut donc pas parler de cause directe, mais plutôt de facteurs susceptibles d’interagir avec une prédisposition déjà présente.
Tu expliques que ces troubles peuvent parfaitement se cumuler entre eux, dans ce cas comment les diagnostiquer précisément pour les prendre en charge de façon optimale ?
C’est une grande question et c’est tout l’enjeu des diagnostics. Cela donne parfois du fil à retordre aux professionnels, car il n’est pas toujours facile de démêler ce qui relève de chaque trouble tant les manifestations peuvent s’entrecroiser.
Il est en effet très fréquent que plusieurs troubles coexistent chez un même enfant. On parle alors de comorbidités. Ces profils « mixtes » sont la règle plutôt que l’exception : par exemple, un enfant peut présenter à la fois un TDAH et une dyslexie, ou un trouble du spectre autistique et une dyspraxie.
Ces recoupements compliquent parfois le repérage, car les symptômes se chevauchent. Un enfant distrait à cause d’un TDAH peut, par exemple, rencontrer des difficultés de lecture sans être dyslexique. C’est pourquoi le diagnostic doit être pluridisciplinaire : orthophoniste, psychomotricien, neuropsychologue, médecin, psychologue… chacun apporte une pièce du puzzle.
L’objectif n’est pas d’empiler les étiquettes, mais de comprendre le fonctionnement global de l’enfant. Plus le profil est compris avec précision, plus on peut proposer un accompagnement ajusté, cohérent et efficace et surtout, redonner du sens à ses efforts et à ses progrès.
Comment un parent peut observer son enfant pour repérer ce type de troubles ? Quand surviennent-t-ils ?
Les premiers signes apparaissent souvent très tôt, mais ils varient selon le type de trouble.
Pour les troubles du langage (comme le TDL, anciennement dysphasie), on peut repérer dès 2 ou 3 ans un retard de langage, une parole difficile à comprendre, ou l’absence de petites phrases.
Pour les troubles des apprentissages (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie), les difficultés émergent généralement entre la grande section et le CP, lorsque l’enfant commence à lire, écrire et compter. On remarque alors des confusions entre les sons et les lettres, une lenteur inhabituelle, une grande fatigue ou des erreurs persistantes malgré les efforts.
Pour les troubles de l’attention ou de la coordination, les signes sont parfois plus diffus : agitation, distraction, maladresse, ou au contraire rêverie excessive. Ce qui doit alerter, c’est surtout la persistance des difficultés dans le temps, malgré un environnement bienveillant et des efforts répétés.
Les parents connaissent mieux que quiconque leur enfant. Quand ils sentent que « quelque chose cloche », qu’il se fatigue vite ou qu’il souffre à l’école, il est important d’écouter cette intuition et d’en parler avec le médecin ou l’enseignant.
Quand est-il judicieux de faire un bilan orthophonique ?
Dès qu’un doute persiste, il ne faut pas hésiter à consulter. Un bilan orthophonique ne signifie pas forcément qu’un trouble est présent : il permet avant tout de faire le point et de rassurer.
L’orthophoniste évalue le langage oral, le langage écrit, la mémoire, la compréhension, et oriente si besoin vers d’autres professionnels.
Et si les délais de prise en charge sont longs, mon enfant risque-t-il de cumuler des retards d’apprentissage ? Comment puis-je l’aider en attendant ?
Oui, les délais peuvent être longs, surtout dans certaines régions. C’est une vraie réalité, et je comprends la frustration des parents. Mais il existe des moyens d’agir en attendant.
D’abord, maintenir le lien avec l’école : informer l’enseignant du projet de bilan, demander des aménagements simples (plus de temps, consignes lues, copie des leçons, polycopiés…).
Ensuite, privilégier à la maison des activités qui nourrissent la confiance et la curiosité : lire ensemble, jouer à des jeux de lettres ou de logique, faire des activités manuelles, cuisiner, bouger… Tout ce qui stimule le langage, la mémoire, la coordination et la réflexion sans que l’enfant ait l’impression de « travailler ».
Faire les devoirs sous forme de jeux aussi, aide à alléger la tâche, comme : apprendre une poésie en échangeant des passes de ballons ou en dessinant, apprendre une leçon d’histoire en chantant, apprendre les mots de dictée en jouant « à la maîtresse », etc.
Et surtout, ne pas mettre la pression. Les enfants sentent très vite l’anxiété des adultes. Il vaut mieux leur transmettre l’idée qu’ils sont en train d’avancer, qu’ils sont accompagnés, et qu’ils finiront par trouver leurs propres outils pour progresser.
En quoi consiste la prise en charge orthophonique, permet-elle de supprimer ces troubles ?
La prise en charge orthophonique ne « supprime » pas les troubles, car ils sont d’origine neurodéveloppementale. Le cerveau fonctionne différemment, il ne s’agit pas d’un simple retard à combler. Mais elle permet à l’enfant de mieux comprendre son propre fonctionnement et de développer des stratégies efficaces pour contourner ses difficultés.
Les séances sont toujours personnalisées. Selon les besoins, elles peuvent viser à renforcer la lecture, l’écriture, la compréhension, les compétences langagières ou logiques. Le but n’est pas seulement d’améliorer une performance, mais de rendre l’enfant plus autonome et plus confiant.
Avec un accompagnement adapté, la plupart des enfants progressent énormément. Le trouble ne disparaît pas complètement, mais s’estompe. Il devient moins handicapant au quotidien, et l’enfant apprend à s’appuyer sur ses forces.
Mon enfant aura-t-il besoin d’un suivi spécialisé tout au long de sa scolarité ?
Pas forcément. La durée du suivi dépend du type et de la sévérité du trouble, mais aussi de la progression de l’enfant. Certains suivis ne durent que quelques mois, d’autres s’étendent sur plusieurs années, avec parfois des pauses ou des bilans de contrôle.
L’objectif de la rééducation est justement d’amener l’enfant à s’émanciper du suivi, en lui donnant des outils durables et une meilleure conscience de ses capacités.
Quand le cadre scolaire est bienveillant et que les aménagements sont en place, beaucoup d’enfants parviennent à poursuivre leur scolarité de manière sereine, sans accompagnement intensif.
Et même pour ceux qui ont besoin d’un suivi à long terme, cela ne veut pas dire qu’ils seront « en difficulté » toute leur vie. Simplement qu’ils apprennent autrement, et que ce mode d’apprentissage mérite d’être respecté et soutenu.
Il existe des traitements médicamenteux pour le TDA, sont-ils dangereux et quels sont les effets secondaires ?
C’est une question que beaucoup de parents se posent, et c’est légitime.
Les traitements médicamenteux comme la Ritaline ou le Concerta ne sont ni obligatoires ni systématiques. Ils sont prescrits uniquement par un médecin spécialiste après un diagnostic complet.
Ces médicaments ne « guérissent » pas le TDAH, mais ils peuvent apporter une réelle aide : mieux canaliser l’attention, réduire l’impulsivité, apaiser la charge mentale. Pour certains enfants, cela change leur rapport à l’école et à eux-mêmes.
Les effets secondaires sont surveillés de près et s’atténuent souvent après ajustement du dosage. Et la prise n’est pas forcément à long terme : certaines familles font des pauses pendant les vacances, ou arrêtent quand l’enfant trouve d’autres stratégies de régulation.
L’essentiel est que le traitement s’inscrive dans une prise en charge globale avec un accompagnement éducatif, psychologique et scolaire. Ce n’est qu’un outil parmi d’autres, à adapter selon chaque enfant.
Comment faire en sorte que ces troubles n’affectent pas mon enfant, et entament sa confiance en lui ?
C’est sans doute le cœur du sujet. Quand un enfant vit des difficultés à répétition, il finit souvent par penser qu’il n’est « pas bon » ou « pas capable ». Il faut donc l’aider à dissocier ses difficultés de sa valeur personnelle. L’idée n’est pas de nier le trouble, mais de le nommer et de l’expliquer. Mettre des mots dessus permet à l’enfant de comprendre que ce n’est pas de sa faute, qu’il ne manque ni d’intelligence ni de volonté, son cerveau fonctionne simplement autrement.
Ensuite, il est essentiel de valoriser ses efforts autant que ses résultats. L’encourager, reconnaître ses progrès, même minimes, c’est lui montrer qu’il avance. On peut aussi l’amener à identifier ses « zones de force » ou de « génie » : là où il se sent à l’aise, curieux, compétent. Cela rééquilibre son image de lui-même.
Enfin, le regard des adultes est déterminant. Un enfant qui se sent compris et soutenu par ses parents et ses enseignants retrouve confiance, même dans la difficulté. La bienveillance, ce n’est pas la complaisance : c’est donner à l’enfant la conviction intime qu’il peut réussir autrement.
Quelles ressources, outils, sites spécialisés peut-on conseiller pour les parents d’enfants neuroatypiques ?
Pour des articles accessibles et de qualité je recommande les sites Allo Ortho et le Blog de Hop Toys rédigés par des professionnels du soin et de l’accompagnement. On peut trouver aussi beaucoup d’informations sur le site de la Fédération Française des DYS (FFDYS).
Le site Le cartable fantastique , propose quant à lui des ressources pédagogiques et numériques bien pensées pour aider les élèves « dys ».
Les associations de parents comme Apedys, Dyspraxie France Dys ou HyperSupers TDAH France sont aussi de précieux relais d’information et de soutien. Elles permettent d’échanger avec d’autres familles et ne pas se sentir seul.
L’autrice : Laura Marie
Laura Marie est orthophoniste, spécialisée dans les troubles des apprentissages. Passionnée par la transmission du savoir, elle conçoit des supports ludiques et concrets pour en faciliter l’accès, comme dans son ouvrage à succès Mon répertoire des régularités orthographiques (2024). Elle a créé « L’ Atelier de l’Orthophoniste » (@latelierdelorthophoniste), un espace dédié à la vulgarisation scientifique et au partage de méthodes pédagogiques innovantes. Écouter son podcast
Mon enfant neuroatypique, éditions Solar, Août 2025.